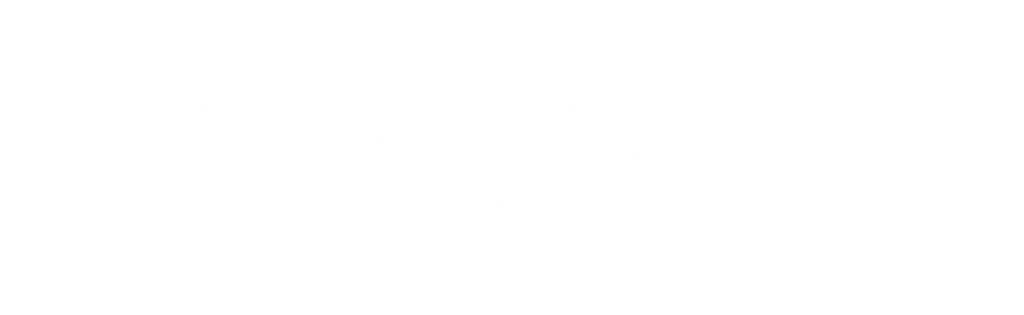Un géant des airs
Le Gypaète Barbu
Une histoire de résilience et de retour
Le Gypaète Barbu (Gypaetus barbatus), aussi appelé le casseur d’os, est le plus grand rapace d’Europe pouvant atteindre 3m d’envergure et un symbole emblématique des hautes montagnes. Son histoire est celle d’une survie remarquable, marquée par une quasi-extinction dû à l’homme et un retour spectaculaire tel un Phoenix grâce aux efforts de conservation. Actuellement, il est classé « Quasi Menacé » selon la liste Rouge de l’UICN.
Des origines préhistoriques et une répartition vaste
Les origines du Gypaète Barbu remontent à des millions d’années – à l’ère du Pléistocène. Appartenant à la famille des Accipitridae, il est unique par son régime alimentaire spécial, se nourrissant exclusivement d’os et de tendons.
Historiquement, le Gypaète Barbu bénéficiait d’une aire de répartition très étendue. On le trouvait dans toutes les grandes chaînes de montagnes d’Europe, d’Asie, et d’Afrique du Nord. En Europe, il était présent dans les Alpes, le Pyrénées, les Balkans, la Crète, et le Caucase.
Le déclin au XIXe et début du XXe Siècle : Une disparition Européenne
Le XIXe siècle et le début du XXe siècle ont été catastrophiques pour les Gypaète Barbu en Europe. Plusieurs facteurs ont conduit à son déclin drastique et à sa quasi-extinction :
Persécution directe :
Considéré comme le descendant du Diable dû à sa couleur orangé (créé par les bains qu’ils prennent dans des sources ferrugineuses) et sa sclérotique rouge autour de l’oeil, il est accusé à tort comme un prédateur de bétail et d’enfants. Pour ses raisons, il a été massivement chassé, empoissé, et ses nids ont été détruits. Des primes étaient même offertes pour sa destruction. Il disparaît complètement des Alpes en 1913, exterminé par ignorance.
Changement des pratiques pastorales :
La diminution du pastoralisme traditionnel et de l’équarrissage a réduit la disponibilité des carcasses et des os, sa principale source de nourriture.
Développement humain :
L’intensification des activités humaines en montagne (tourisme, infrastructures) a perturbé ses habitats de reproduction.
En conséquence, le Gypaète Barbu a disparu de la plupart des massifs européens. Dans les Alpes, le dernier individu a été abattu en 1913. Seules quelques populations isolées ont survécu dans les Pyrénées, en Corse, en Crète et dans certaines régions du Caucase et d’Asie.
La renaissance
Le programme de réintroduction des années 1970 – 1980
Face à l’urgence de la situation, la communauté scientifique et les organisations de conservation ont sonné l’alarme. Dès les
années 1970, un ambitieux programme international de réintroduction a été initié, principalement par l’UICN, la WWF, et la société zoologique de Francfort.
Les étapes clés de ce programme ont été les suivantes :
Élevage en captivité :
Des efforts considérables ont été faits pour établir un pool génétique sain à partir d’oiseaux captifs ou récupérés dans la nature. Des centres d’élevages spécialisés ont vu le jour.
Lâcher d’oiseaux juvéniles :
C’est en 1986 que les 3 premiers juvéniles ont été lâcher dans les Alpes autrichienne. En 1987, c’est en Haute-Savoie qu’on assiste au premier lâcher en milieu naturel. C’est une réussite emblématique de la conservation.
La technique de « hacking »
Lâcher de jeunes oiseaux dans des sites naturels sans présence humaine, pour qu’ils s’imprègnent du milieu a été privilégiée pour favoriser leur adaptation et leur retour à la vie sauvage.
Surveillance et suivi :
Un suivi rigoureux des oiseaux relâchés a été mis en place, grâce à des balises et des observations, pour comprendre leurs déplacements, leurs survies et leurs reproductions.
Le retour progressif et les défis actuels
Grâce à ces efforts concertés, le Gypaète Barbu a progressivement recolonisé une partie de son ancienne aire de répartition. Cependant, malgré ce succès remarquable, le Gypaète Barbu fait toujours face à des défis :
Poisons et chasse :
L’utilisation illégale de poisons (notamment les appâts empoisonnés contre les loups ou les renards) reste une menace majeure et la principale cause de mortalité non naturelle. Les tirs illégaux, sont également beaucoup trop nombreux.
Électrocution et collision :
Les lignes électriques, les câbles des remontées mécaniques et les éoliennes sont des catastrophes mortelles pour ces grands planeur.
Perturbation des nids :
Les activités humaines (escalade, aéronefs, parapente) à proximité des sites de nidification peuvent entraîner l’échec de la reproduction.
Disponibilités des ressources :
Assurer une quantité suffisante d’ongulés sauvages, mammifères, et domestiques (par l’équarrissage naturel ou des charniers contrôlés) reste crucial.
Faible taux de reproduction :
Le Gypaète Barbu devient reproducteur à l’âge de 7ans ; Il a l’une des reproductions les plus lentes donnant en plus, un seul poussin par an, ce qui rend chaque perte plus significative. Il faut donc qu’il survive dans la nature ses 7 premières années avant de pouvoir se reproduire. C’est également fréquent que la première reproduction échoue chez un jeune couple.
Aujourd’hui : Un symbole d’espoir
Aujourd’hui, le Gypaète Barbu est plus qu’un simple rapace ; il est un symbole puissant de la réussite de la conservation et de la résilience de la nature. Sa présence dans nos montagnes témoigne de l’importance de la protection des espèces et des habitats. Les efforts continuent pour assurer la pérennité de cette espèce magnifique, notamment par la sensibilisation du public, la lutte contre les poisons et le dérangement des zones de nidification.
Mon engagement aux côtés du Gypaète Barbu
Je suis tellement reconnaissante de l’immense privilège que j’ai de pouvoir suivre cette espèce tout au long de l’année, en haute montagne. Observer les Gypaète Barbu dans leur milieu naturel, les accompagner discrètement durant leur cycle de reproduction, depuis la construction du nid jusqu’à l’envol de poussin, est une expérience profondément marquante qui m’émeut. Chaque observation, chaque envol, chaque regard croisé, et chaque envol au-dessus de moi, car certains me reconnaissent, résonne comme un rappel de leur force, de leur fragilité, et de notre responsabilité à les préserver. Je leurs suis reconnaissante de me laisser les côtoyer, avec respect, humilité et amour, au rythme de la montagne et des saisons.